Depuis quelques années, je n’hésite pas à dire ici et là que Le Livre malazéen des glorieux défunts est ma série de fantasy préférée. Et plus que cela, je considère l’ensemble créé par Steven Erikson et Ian C. Esslemont comme l’univers de fantasy le plus ambitieux, riche et réussi depuis Tolkien. Si j’ai commencé à chroniquer les différents volumes les uns après les autres, je n’avais pas encore essayé d’expliquer un peu en détail, autrement que par oral, ce qui fait la grandeur de cette œuvre et pourquoi il serait dommage que le lecteur francophone ne puisse en profiter dans son intégralité.
(Note : Les traductions des extraits sont personnelles et peuvent donc ne pas refléter la qualité de la plume, comme le lecteur anglophone pourra le constater.)
(Note 2 : Depuis la publication de cet article, la série a été reprise en français par un nouvel éditeur, mais je n’ai pas édité l’article, essentiellement par fainéantise)
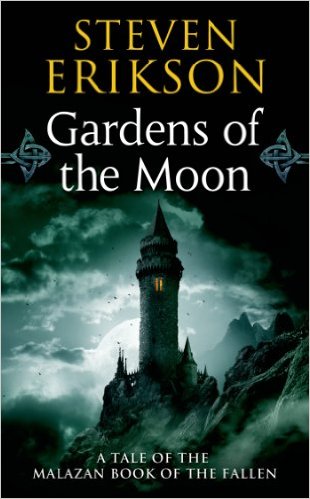 Les origines de la saga et ses auteurs
Les origines de la saga et ses auteurs
« What makes a Malazan soldier so dangerous? They’re allowed to think. » (Ce qui rend un soldat malazéen si dangereux ? Ils sont autorisés à penser.)
Commençons par nous intéresser aux auteurs et la genèse de leur univers. Tout comme avec Tolkien, il y a un lien direct et profond entre le créateur et sa création. Steven Erikson (de son vrai nom Steve Rune Lundin) et Ian Cameron Esslemont sont deux canadiens qui se sont rencontrés sur les bancs de l’université où ils étudient l’archéologie et l’anthropologie. Les deux compères sont aussi rôlistes et c’est en développant leur propre univers de jeu de rôle qu’ils posent les bases de l’univers malazéen. Après quelques années, le matériau s’accumule et Erikson et Esslemont décident d’écrire un script de film qu’ils essaient ensuite de vendre aux studios. Mais à l’époque l’adaptation par Peter Jackson de l’œuvre de Tolkien n’est encore qu’un rêve lointain et George R. R. Martin n’a pas encore publié le premier volume de la série qu’HBO adaptera sous le titre Game of Thrones. On leur conseille de revoir leur script et de proposer quelque chose de plus simple et de moins ambitieux. Or les deux jeunes hommes ne veulent pas se limiter alors qu’ils ont matière à quantité de romans ou de films.
La vie finit par séparer les deux compères qui suivent chacun leur voie professionnelle. Mais leurs notes sont toujours là et ils s’accordent pour écrire chacun un roman. Erikson réécrit leur script pour en faire Gardens of the Moon et Esslemont commence ce qui deviendra Return of the Crimson Guard. Erikson doit ensuite faire face au même problème que pour le script : trouver un éditeur qui accepte de le publier. Et la quête va être aussi longue ou presque que le siège de Troie. Dans l’intervalle, il commence à publier d’autres ouvrages sous son vrai nom. A la fin des années 1990, Erikson trouve preneur au Royaume-Uni chez Transworld, qui gère la branche britannique de Bantam. Gardens of the Moon sort en 1999 et Erikson reçoit alors une offre d’un éditeur concurrent. Bien décidé à ne pas perdre son nouvel auteur, Transworld lui propose alors un contrat pour neuf volumes supplémentaires. La machine est enclenchée. Quelques années après, Esslemont est à son tour publié.
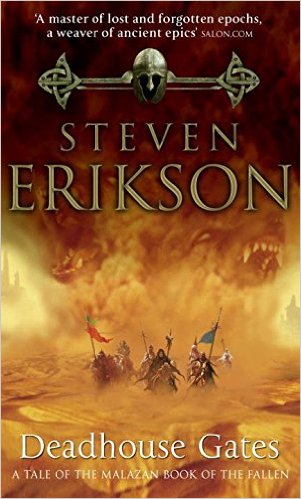 L’histoire
L’histoire
« Now these ashes have grown cold, we open the old book. » (Maintenant que les cendres ont refroidi, ouvrons le vieil ouvrage.)
De quoi parle Le Livre malazéen des glorieux défunts ? Est-il seulement possible de résumer la chose en quelques mots ? Tout au plus puis-je dire que le point commun entre la plupart des livres est l’empire malazéen, une entité politique expansionniste dont les ambitions entraînent des conflits sur plusieurs continents. Gardens of the Moon, le premier roman publié, suit ainsi le parcours d’un groupe de soldats malazéens sur un continent étranger. Vétérans de nombreuses campagnes, on leur confie une nouvelle mission qui pour certains semble être la mission de trop.
De façon plus générale, il est difficile de donner un point de départ précis de l’histoire. Pour la bonne et simple raison que l’histoire, celle qu’étudient les historiens et que les politiques essaient de s’accaparer, n’a pas de point de départ. Il y a toujours un avant à chaque événement. Et même si l’on peut dater le début de l’histoire d’un personnage à sa naissance ou celle d’un pays à sa fondation (pour ceux qui en ont une clairement identifiable), on parle toujours de l’avant quand on évoque ce commencement (les parents, les entités qui précèdent l’état, etc.) On retrouve cet effet dans certains ouvrages de fantasy, mais la chose est rarement aussi évidente que chez Erikson. Ici, le monde entier a un passé. Chaque ville est construite sur les ruines d’une autre, chaque civilisation succède à une autre, chaque peuple a une ascendance et même les religions plongent leurs racines dans d’autres.
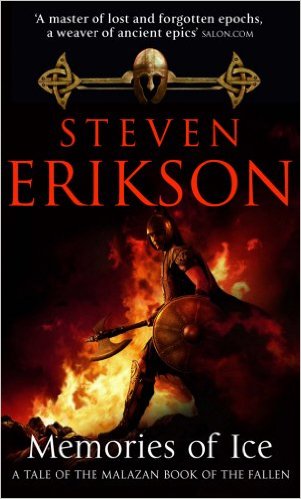 Le monde malazéen en tant qu’univers de fantasy
Le monde malazéen en tant qu’univers de fantasy
« Fucking dragon. » (Putain de dragon.)
Sans me lancer dans le débat de ce qui définit un univers de fantasy (le problème serait le même qu’avec la SF), je peux tout de même proposer quelques éléments ni nécessaires, ni suffisants, mais fréquemment associés au genre. On aura ainsi fréquemment de la magie. On trouvera aussi régulièrement différentes espèces intelligentes et des créatures fantastiques. Erikson n’a pas hésité à incorporer ces trois éléments dans son univers. On est ainsi loin du Trône de Fer de George R. R. Martin tant la magie est présente, mais elle conserve parfois ce côté effrayant que lui donne Glen Cook dans La Compagnie Noire. La mise en scène de cette magie est d’ailleurs originale puisque les sources des différents types de magie sont aussi des dimensions dans lesquels les personnages peuvent se déplacer et ne sont pas des entités statiques mais tout aussi vivantes que les protagonistes.
Le monde est évidemment peuplé de diverses espèces intelligentes, plus ou moins proches de l’humanité et plus ou moins anciennes. Y compris des êtres tellement vieux (et pour certains assez dépressifs) qu’ils font passer les Maiars de Tolkien pour de petits jeunots. Enfin, on pourra profiter d’un bestiaire qui compte son lot d’étrangetés sans pour autant négliger de grands classiques comme les démons et naturellement les dragons.
Le Livre malazéen des glorieux défunts n’échappe pas non plus à l’une des habitudes des séries de fantasy : les ouvrages contiennent des cartes, une liste des personnages et une annexe détaillant quelques informations sur l’univers. De façon plus générale, les nombreux éléments que l’on croise à travers le cycle sur le passé de cet univers donnent à penser que les auteurs peuvent continuer à y raconter nombre d’histoires sans jamais tourner en rond.
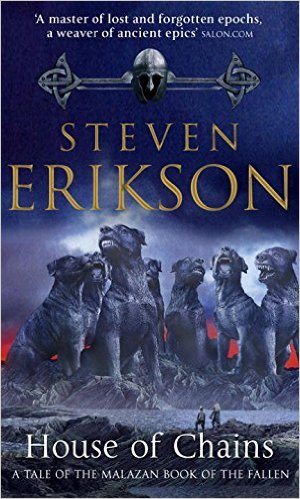 Le livre des glorieux défunts comme récit épique
Le livre des glorieux défunts comme récit épique
« Every decision you make can change the world. The best life is the one the gods don’t notice. You want to live free boy, live quietly. » (Tous les choix que l’on fait peuvent changer le monde. La vie idéale est celle que les dieux ne remarquent pas. Petit, si tu veux vivre libre, vis tranquillement.)
Les amateurs de classification connaissent les différents sous-genres de la fantasy : high fantasy, low fantasy, light fantasy, sword and sorcery, heroic fantasy, etc. Le monde secondaire riche et détaillé classe cette œuvre du côté de la high fantasy. Mais il s’agit aussi d’un récit épique et héroïque. Et je ne parle pas dans le sens commun adopté aujourd’hui, à savoir une histoire avec de l’aventure, des bastons et des personnages principaux sympas et courageux face au danger. Non, je parle d’une épopée avec des héros, au sens homérique. C’est-à-dire des personnages qui confinent au divin accomplissant des exploits totalement hors norme.
Les rôlistes pourront légitimement s’inquiéter du grosbillisme que mon affirmation peut faire craindre. Il est donné à n’importe qui de décrire un personnage comme étant d’une puissance sans égale, capable de soulever les montagnes et de faire tomber la foudre en claquant des doigts. Mais c’en est une autre que de le faire croire au lecteur (dans mon cas, personne n’y croirait). En anglais, il y a un dicton qui dit « show, don’t tell » (montrez, ne racontez pas). Et trop souvent, les auteurs de fantasy font du tell et lorsqu’ils font du show, on n’y croit pas toujours. Erikson a réussi à me faire croire à des personnages proprement hors normes. Avec lui, la puissance divine se ressent et se vit. Mais sans jamais oublier qu’il y parfois un prix à payer : Achille n’a-t-il pas sacrifié son espérance de vie pour accéder à la gloire éternelle ?
Parlons d’ailleurs quelques secondes de toute la palette de personnages mis en scène. La distribution est généreuse et n’a pas trop à rougir niveau effectif face aux ténors du genre que sont Robert Jordan et George R. R. Martin. Mais la quantité ne sert à rien si la qualité ne suit pas. Et Erikson nous gâte de ce côté. Chacun a sa personnalité et ses objectifs personnels, même ceux qui paraissent parfois totalement superficiels. Je pourrais facilement citer quelques dizaines de personnages qui m’ont laissé une impression durable.
Le récit contient de multiples occasions pour les personnages de briller. Et on ne se limite pas aux classiques guerriers, mages et voleurs/assassins. Tous peuvent avoir leur heure de gloire, ce petit moment qui permet d’immortaliser un individu dans le souvenir des autres, de graver à jamais un personnage dans la mémoire du lecteur. Bien évidemment, les batailles sont présentes. Il est question d’un empire en guerre et peu d’aspects des conflits échapperont au lecteur. De la guerre de siège à la grande bataille en plaine en passant par la guérilla et les courses poursuites entre assassins sur les toits. L’action est là et Erikson la décrit à merveille.
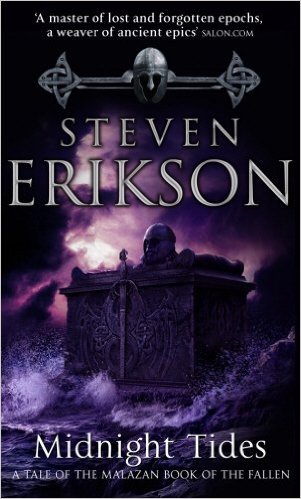 Le divin
Le divin
“Never, dear gods. Never mess with mortals.” (Jamais, ô dieux, non jamais ne touchez aux mortels.)
L’un des points de comparaison que j’évoque parfois pour parler de cette série est l’Iliade et l’Odyssée d’Homère. Et cela pas seulement pour le côté épique développé précédemment mais aussi pour le divin. Car les dieux existent dans cet univers et pour eux la vie n’est pas un long fleuve tranquille.
Les annexes des ouvrages présentent une partie des dieux organisés en maison, reflétant le tarot (appelé Deck of Dragons) utilisé par certains pour faire des prédictions. Si l’on peut y voir un petit côté rôlistique, sans parler d’une référence à Ambre de Roger Zelazny, on a surtout un reflet des oppositions qui existent entre les dieux. Un peu à la façon dont les divinités se répartissent entre achéens et troyens dans l’Iliade. De plus, la séparation entre mortels et divins n’est pas toujours nette et franche. On trouve des protagonistes qui rentrent bien dans la catégorie des demi-dieux et c’est véritablement une expérience à part que d’assister à la transcendance d’un personnage.
Et si les dieux manipulent les mortels, détournant leurs destinées pour assouvir leurs envies, les mauvais coups ne touchent pas que ces derniers. Une manipulation peut se faire à double sens et parfois les dieux aussi paient le prix de leurs actes.
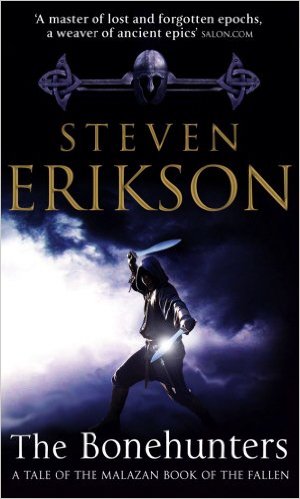 De la critique
De la critique
« Children are dying. The injustices of the world hide in those three words. » (Des enfants meurent. Les injustices du monde se cachent dans ces trois mots.)
Tout comme les autres littératures de genre (science-fiction, polar, historique, etc.) la fantasy permet non seulement le divertissement du lecteur mais aussi d’ouvrir ce dernier à la réflexion. Et Le Livre malazéen des glorieux défunts en propose plusieurs. En commençant par la fantasy elle-même. D’une certaine façon, Erikson déforme les schémas narratifs habituels de la fantasy tout en y faisant hommage. On sera ainsi surpris régulièrement par la tournure des événements sans que cela devienne systématique. Et même après cinq ou six volumes, quand on croit être au bout des surprises, il arrive toujours quelque chose que l’on n’avait pas vu venir.
En mettant en scène un univers en guerre et dans lequel on peut trouver des conflits politiques de toutes sortes, de l’esclavage ou encore de l’exploitation économique, les occasions de se prêter à la réflexion ne manquent pas et les personnages eux-mêmes s’interrogent parfois sur le sens du monde qui les entoure.
Erikson prend aussi le lecteur à contre-pied dans son traitement de l’égalité sexuelle. Ici, le genre ne définit pas le rôle d’un individu et l’auteur l’exploite à merveille en jouant sur les présupposés du lecteur. On suivra ainsi un soldat pendant plus d’une page avant de réaliser qu’il s’agit d’une femme. Et on ne sent pas que des figures féminines fortes sont créées dans le but de montrer au lecteur « regardez, avec une femme aussi ça fonctionne. » Lorsque les personnages ont besoin de prouver quelque chose, ce n’est jamais lié à leur genre. Je remarque la même subtilité dans l’approche des relations homosexuelles, traitées de la même façon que les relations hétérosexuelles, sans emphase particulière.
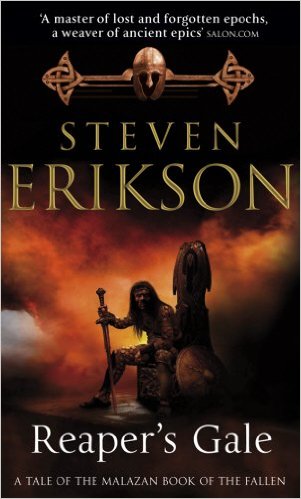 La série en tant qu’œuvre littéraire
La série en tant qu’œuvre littéraire
« The soul knows no greater anguish than to take a breath that begins in love and ends with grief. » (L’âme ne connaît pas de plus grande angoisse que de prendre une inspiration qui commence dans l’amour et finit dans la peine.)
Le style d’un auteur peut faire beaucoup pour une œuvre (ou parfois contre) et je crois que c’est particulièrement vrai dans le cas de Steven Erikson. A l’opposée d’un George R. R. Martin à la plume relativement « simple » (contrairement à ce que sa traduction française laisse croire), il emploie un vocabulaire assez riche et pas toujours facile pour le lecteur anglophone. Paradoxalement, le francophone lisant en anglais a parfois plus de facilité à comprendre car certains mots peu courants qu’emploie Erikson viennent du français. Cette richesse de vocabulaire permet à l’auteur d’être précis dans son expression. Elle lui permet aussi d’afficher régulièrement une certaine puissance dans les phrases qu’il offre au lecteur et plus d’une fois je me suis surpris à relire un passage à haut voix pour en apprécier pleinement le souffle.
La série a aussi pour moi un gros avantage sur certaines autres : elle est composée de dix romans. Et pas de dix parties d’un même roman. On pardonnera volontiers à Tolkien d’avoir écrit une trilogie involontaire puisque son découpage lui fut imposé par son éditeur. J’ai par contre moins d’indulgence envers les divers premiers volumes de série qui se résument à une introduction des personnages, la mise en place de diverses intrigues et où au bout de trois cents, quatre cents, voire cinq cents pages on laisse les protagonistes dans la panade en concluant d’un « la suite au prochain épisode. » En vieillissant, j’apprécie de plus en plus qu’un livre soit un roman avec un début, un milieu et une fin. Et de ce point de vue, Erikson me comble. Après chaque roman, j’ai l’envie de lire le suivant pour savoir comment va évoluer la situation et ce qu’il va advenir de certains personnages. Pourtant, je n’éprouve pas cette frustration qui me saisit parfois lorsqu’à la fin de l’ouvrage à peu près tout reste en plan. Erikson pose des enjeux à chaque ouvrage et à la fin du volume, une bonne partie de ces enjeux sont résolus ; sans arriver pour autant à la situation où le fait de ne pas lire la suite ne me gênerait pas. J’ai parlé plus haut du fait que l’histoire n’a pas de commencement, on peut donc légitimement supposer qu’elle n’a pas non plus de véritable fin. Il se passera toujours quelque chose après. Et avec cet univers, je suis toujours prêt à lire ce « quelque chose ».
J’ai connu plus d’une série où le premier volume était plein de qualité que j’avais du mal à retrouver dans les épisodes suivants, probablement écrits plus rapidement ou sous une pression plus importante. Ici, les romans suivants sont au contraire qualitativement supérieurs au premier. Gardens of the Moon a été écrit plusieurs années avant le reste de la série et Erikson était moins expérimenté comme auteur. Cela n’en fait pas un roman mauvais ou moyen. Comparé à la majorité des œuvres de fantasy, il se place au-dessus, mais il est simplement en dessous des autres épisodes de la série.
Le Livre malazéen des glorieux défunts contient sa part de tout ce qui fait la fantasy et le récit épique. Mais on arrive aussi à y trouver de l’humour, parfois égrené comme de petites respirations aidant le lecteur à traverser des phases émotionnellement intenses. De la romance aussi, souvent disséminée à travers tout le récit, parfois cachée, souvent tragique et toujours belle.
Dans mon parcours de lecteur, j’ai lu quantité de livres marquants, de personnages que j’ai apprécié et de scènes dont je garde un souvenir. Mais ce sont généralement des souvenirs de lecture, ce que je pourrais appeler les souvenirs des souvenirs des personnages et pas mes souvenirs propres. Et parfois, on vit la scène au point que le souvenir qu’on en garde n’est pas celui de la lecture, mais le souvenir de la chair. Erikson m’a procuré ce genre de souvenir. Et il y quelques semaines, parcourant un résumé d’un des chapitres de Deadhouse Gates, livre que j’ai lu il y a une dizaine d’années, un de ces souvenirs est remonté à la surface et j’ai eu envie de pleurer tant l’émotion était forte. Je n’avais pas de mot pour exprimer ce que je ressentais.
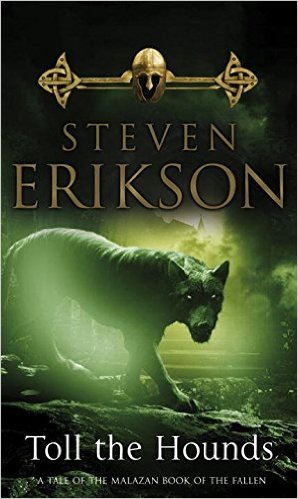 L’accessibilité
L’accessibilité
« What the soul can house, the flesh cannot fathom. » (Ce que l’âme peut abriter, la chair ne peut le comprendre.)
Dans mes chroniques, j’ai parlé du fait que cette série n’est pas la plus accessible qui soit et qu’elle demande un peu d’attention de la part du lecteur. Je ne suis pas le seul à souligner le côté un peu ardu de cette série. Il est toujours un peu curieux d’essayer de convaincre un lecteur potentiel tout en lui disant « mais attention, ce n’est pas facile à lire. » En commençant à tracer un plan de cet article, je ne savais pas trop comment aborder ce point et je suis en train de me rendre compte de quelque chose.
Le Livre malazéen des glorieux défunts est une œuvre riche et complexe. Le monde dans lequel a lieu le récit est extrêmement détaillé, tout semble y avoir été pensé, le moindre élément semble avoir toute une histoire derrière lui. Tout n’est pas toujours expliqué le plus clairement du monde et certaines choses sont sujet à interprétation et font parfois l’objet de débats entre fans. Le lecteur dispose de cartes et d’une ou deux annexes pour l’assister. Le texte contient quantité de poèmes ou de chansons, qui parfois ne sont pas anodins. La plume est riche et puissante.
Ce n’est pas une œuvre que je conseillerais à un lecteur débutant en fantasy. Pourtant, lorsqu’il y a près de vingt ans j’ai commencé à m’intéresser à ce genre, la première œuvre que j’ai lu est bien décrite par le paragraphe précédent : Le seigneur des anneaux. Et je suis loin d’être le seul à avoir fait mes premiers pas dans le genre avec ce roman. Alors qu’en est-il en fin de compte ? Peut-être qu’en vieillissant en tant que lecteur on oublie que le lecteur novice est déjà capable de s’adapter. D’autant plus qu’en y réfléchissant, Gardens of the Moon est peut-être plus abordable que Le seigneur des anneaux et son prologue parlant des hobbits et de l’herbe à pipe. Et dans le domaine de la SF, Dune n’est pas l’ouvrage le plus accessible qui soit et pourtant quantité de lecteurs en ont fait une de leurs premières expériences dans le domaine.
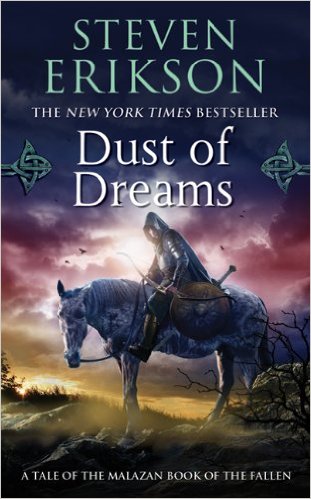 Comparaison avec d’autres œuvres
Comparaison avec d’autres œuvres
« Hunger for vengeance poisoned the soul. » (La soif de vengeance empoisonne l’âme.)
Lorsque je dis que Le Livre malazéen des glorieux défunts est la meilleure série de fantasy qui soit, c’est évidemment un avis personnel et pas une vérité absolue. Cependant, mon avis est basé sur près d’une vingtaine d’années de lecture de fantasy. Tout comme en SF, il y a des classiques ou des incontournables que je n’ai pas encore abordés, mais je pense avoir quand même goutté à quelques-unes des sagas les plus marquantes du genre : Le seigneur des anneaux, L’arcane des épées, La roue du temps, Le trône de fer, La belgariade, Shannara, Les chroniques de Krondor, L’épée de vérité… sans parler des univers de fantasy que je ne qualifierai pas de sagas mais pourtant important : Le Disque-Monde, La Terre mourante… Bref, j’ai lu et souvent aimé beaucoup de séries de fantasy. Tout ça pour dire quoi ? Simplement que si je ne devais conserver qu’une seule œuvre de fantasy, ce serait celle d’Erikson.
Si je devais tracer une généalogie à l’ouvrage, son parent le plus proche me paraît indiscutablement la série de La Compagnie Noire, de Glen Cook. Non seulement l’inspiration est revendiquée par Erikson, mais elle apparaît assez évidente au lecteur du premier volume : une bonne partie des personnages sont des soldats aguerris et fatigués d’avoir tant combattu sans jamais en voir le bout. Cette filiation est d’ailleurs pleinement acceptée par Cook qui qualifie sa propre œuvre de présage à celle d’Erikson.
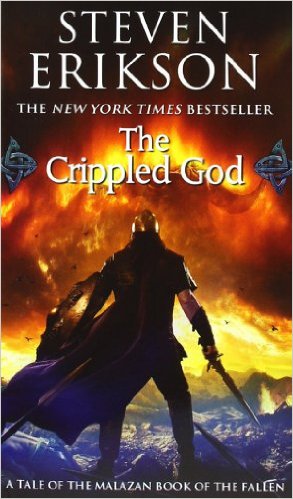 Le parcours français de l’œuvre
Le parcours français de l’œuvre
« An army that waits is soon an army at war with itself. » (Une armée qui attend est rapidement une armée en guerre contre elle-même.)
Pour finir, parlons un peu du Livre malazéen des glorieux défunts dans la langue de Molière. En 2001, les éditions Buchet-Chastel publient Les jardins de la Lune puis plus rien. La collection fantasy de l’éditeur, qui abritait entre autres Stephen Lawhead, ne comptera pas d’autre volume de la série et s’éteindra tranquillement quelques années après.
Fin 2005, les éditions Calmann-Lévy lancent leur collection de fantasy et en 2007 rééditent Les jardins de la Lune. L’année suivante sortent Les portes de la maison des morts et La chaîne des chiens, découpage en deux volumes de Deadhouse Gates. Puis plus rien, une nouvelle fois. La collection meurt en 2009 et renaît de ses cendres sous le label Orbit. Mais sans Erikson. Tad Williams et Mary Stewart feront eux aussi les frais de l’opération.
Le Livre malazéen des glorieux défunts a eu la chance d’être lancé deux fois en France, chose assez rare. Et pourtant, à chaque fois les choses se sont arrêtées rapidement. A qui la faute ? Les éditeurs, le public ? Il n’est pas important de se trouver un coupable, mais il peut être utile de comprendre ce qui s’est passé afin de ne pas répéter la même erreur.
Alors, la série de Steven Erikson peut-elle revenir en français ? En tout honnêteté, je l’ignore. La connaissance que j’ai de l’édition, celle d’un amateur éclairé, me fait penser qu’entreprendre une édition française à la hauteur de l’œuvre ne peut pas être une petite entreprise mais bien un vrai défi pour la maison d’édition qui s’y attaquerait : retraduction des deux premiers romans puis traduction des huit suivants, éviter les découpages autant que possibles, communiquer véritablement auprès du public et des libraires, etc. La tâche s’annonce épique. Mais si tout se passe bien, une fois fini la série principale, il y a déjà plusieurs séries dérivées qui contenteront n’importe quel éditeur ou lecteur boulimique.
Finalement, peut-on priver le lectorat francophone de cette œuvre ? Ce serait comme ne pas avoir traduit Le seigneur des anneaux, Dune, La roue du temps ou Hypérion. Quand une telle ambition est servie par un tel talent, ce n’est plus une question de possibilité, c’est une question de nécessité.
Ben voilà! Une super série avec une envie éééééénorme de la lire…. en anglais! Ce n’est pas que je ne lise pas en VO, c’est surtout que je lis nettement plus lentement (et le Collins sur les genoux au cas ou)
Tortionnaire!
Bon, je vais tacher de trouver les 3 premiers tomes en français. Merci de cet historique.
Si j’en crois Place des libraires, les trois volumes édités par Calmann-Lévy sont toujours disponibles. Après, il faudra malheureusement passer à l’anglais si un éditeur français (de préférence sérieux et avec les reins solides) ne se décide pas à reprendre la série. Le niveau d’anglais n’est pas le plus simple, je trouve, mais il n’y a rien d’insurmontable. 🙂
Bel article, il n’y a plus qu’à l’envoyer aux éditeurs français, ça va peut-être les convaincre. Oui, c’est beau de rêver un peu… 😀
Ce sont surtout les lecteurs (potentiels) qui devraient écrire aux éditeurs. 🙂
Très intéressant article !
Juste, je ne sais pas si j’ai raté ou mal compris quelque chose, mais que devient Esslemont ?
Ah oui, je n’ai pas vraiment développé les autres séries dans le même univers.
Le Livre malazéen des glorieux défunts est la série principale de dix romans écrits par Steven Erikson. Esslemont a donc signé plus tard un contrat pour plusieurs livres et en 2007 le premier d’entre eux, Night of Knives, a été publié. Il a été suivi de cinq autres romans (donc Return of the Crimson Guard, le premier qu’il a écrit) qui se passe plus ou moins en parallèle du Livre malazéen des glorieux défunts.
Les deux auteurs se sont ensuite engagés dans l’écriture d’une trilogie de préquelles chacun. A ce jour, Erikson a publié deux des trois volumes de sa trilogie et Esslemont le premier de la sienne. Erikson a aussi dans ses cartons un autre projet de trilogie toujours dans le même univers. Sans parler d’une série de novella, six à ce jour, dont la première a été publié en 2002. 🙂
Un article magistral (et je pèse mes mots), bravo.
D’après la page facebook du type qui fait campagne pour la traduction française de l’ensemble du cycle, ce dernier a (à nouveau) été refusé ces derniers mois par l’ensemble des gros éditeurs français, de l’Atalante à Bragelonne en passant par Mnemos. Et ce toujours pour les mêmes raisons : trop élitiste, trop de tomes, des romans trop gros, un tome 1 trop ardu, pas assez de lecteurs potentiels, s’est déjà planté deux fois en France, etc.
Je suis les péripéties de cette entreprise depuis un moment. Et si j’admire la ténacité du type qui s’en occupe, j’avoue ne pas croire une seconde aux chances de réussite sans accompagnement par un éditeur un tant soit peu costaud. Personnellement, je pense qu’il faut une boite au minimum de la taille de Bragelonne pour y parvenir. Ces derniers ayant déjà refusé de s’en occuper (pour tout un tas de raisons) il n’y a pas vraiment d’acteur sur le marché capable de s’en occuper. Ce qui met un peu en évidence l’un des problèmes du marché français de l’imaginaire : pas de vrais gros éditeurs impliqués dans le domaine.
Certes, Hachette, Madrigall (Gallimard + Flammarion) et autres publient de l’imaginaire, notamment en poche. Mais ils n’ont pas de collections de grands formats digne de ce nom et capable de vraiment s’imposer sur le marché. Par le biais de Denoël (structure en perpétuel déficit) Madrigall possède certes la collection Lunes d’encre, ainsi que Pygmalion. Mais l’un comme l’autre sont des entités avec un volume d’activité assez « faible » et dans le cas de Pygmalion qui a abandonné à peu près tout ce qui n’était pas Trône de Fer et Assassin Royal.
Hachette, premier groupe d’édition français (environ 200 fois le poids de Bragelonne), est propriétaire de magnifiques collections de SF et de Fantasy… au Royaume-Uni et aux États-Unis : Gollancz et Orbit. Ce sont d’ailleurs eux qui par l’intermédiaire de Calmann-Lévy ont tenté de relancer Erikson. Encore aurait-il fallait qu’ils disposent d’une collection avec un minimum d’influence sur le marché pour y parvenir. Ce que la collection fantasy de Calmann-Lévy n’était clairement pas (pas de vraie locomotive au catalogue, maquette + couverture pas terribles, etc.)
Bref, je pense qu’une partie du problème vient de l’absence d’acteur disposant d’une réelle puissance de frappe sur le marché français. Bragelonne serait probablement à peine capable d’y parvenir (et encore en se mettant peut-être un peu en danger). Les autres acteurs de l’imaginaire, qu’il s’agisse de L’Atalante, Mnémos, Le Bélial ou autre, sont nettement trop petits pour pouvoir soutenir un tel projet. Et c’est bien dommage.
Très bel article.
Comme toi je suis fan de cette série, bien que je ne peux me permettre de la conseiller au regard du fait que seul 2 tomes sont disponibles en VF.
Par contre, peut-être serait-il intéressant que tu cites la page FaceBook du gars qui mène le projet de traduction, ne serait-ce que pour que ceux qui seraient intéressés par avoir une version VF de cette épopée puisse s’y inscrire et ainsi faire grossir le nombre de lecteurs potentiels attendus… Ce qui ne pourrait qu’avoir un impact positif pour décider un éditeur de prendre un tel risque.
Petite question de néophyte en terme d’édition, mais, l’auteur étant canadien, et les québecois parlant français, n’y-a-t-il pas une maison d’édition francophone qui pourrait reprendre le flambeau côté Québec, s’offrant ainsi le marché français en prime du fait de l’absence de traduction des futurs tomes ?
Effectivement, il y a une page Facebook (https://www.facebook.com/groups/378002892265163/) qui soutient le projet de reprendre la série en français. S’y inscrire ne peut pas faire de mal, mais je doute très sincèrement de l’impact de cette page sur les éditeurs. S’inscrire sur une page FB, c’est un clic, ça ne demande pour ainsi dire aucun effort et ça ne permet pas réellement de juger que les gens sont prêts à se lancer dans l’achat d’une série complète de dix pavés à 25-30€ chaque.
Comme je l’ai dit en réponse à un autre commentaire, la chose que les lecteurs potentiels peuvent faire c’est écrire aux éditeurs, en particulier à ceux avec une véritable capacité à reprendre le projet. Envoyer un mail à un ou plusieurs éditeurs, c’est déjà nettement plus pro-actif comme démarche et ça démontre un minimum l’intérêt du lecteur pour la série. Le lecteur aura pris le temps de chercher comment contacter le(s) éditeur(s) et d’écrire un message (et si ça dépasse les deux-trois lignes c’est encore mieux). Je pense que cent mails peuvent avoir plus d’impact que mille clics sur une page FB. 🙂
Je connais très peu le paysage éditorial québecois, j’en connais un seul éditeur de nom (éditions A Lire). Et bien que j’ai entendu dire que les canadiens francophones liraient en moyenne plus d’imaginaire que les français, je doute un peu de l’existence d’éditeurs assez grands et solides pour supporter un tel projet. De plus, il y a un océan entre le Canada et la France et ça joue pas mal sur la capacité d’un éditeur d’un côté à trouver du public de l’autre côté. On peut bien évidemment trouver des ouvrages de A Lire chez nous, tout comme les canadiens peuvent accéder au catalogue de certains éditeurs français, mais c’est généralement moins facile et plus cher (faire traverser l’Atlantique à des livres c’est autre chose que de les faire venir d’un entrepôt « local »). J’ai d’ailleurs vu plus d’une fois des gens au Canada râler sur le prix que leur coûte les livres venus de France.
Oui mais entre râler et ne pas avoir la possibilité de l’acheter. Et puis le français étant par nature râleur, ça ne changerait pas beaucoup de choses ^^.
Quant à écrire aux maisons d’édition, le résultat a toujours été un silence long et glaçant ou bien un refus poli mais ferme.
Du coup, plutôt que de s’arrêter là, la page FB est toujours mieux que rien, d’autant plus que l’instigateur ne fait pas que d’offrir un bouton à presser, mais réalise aussi la traduction gratuite d’un des tomes, afin d’aider à la sortie.
Et puis, au-delà de l’impact sur les éditeurs, ça permet surtout à ceux qui seraient interessés d’avoir un espace où s’informer de ce qui se passe… en espérant qu’un jour Molière embrasse Erikson.
Excellent article, qui donne envie de lire la saga.
Article conseillé par un ami…
Voila, c’est malin … je n’ai plus qu’une envie … Lire les 10 tomes en anglais !!
Le souci avec ce genre de saga, c’est que j’ai un mal fou à « décrocher » une fois que je suis dedans !!… et certains se plaignent de mon manque de disponibilité !!…;-)
Bref, merci !!..