Dans le cadre de la parution de son ouvrage sur La guerre de Sécession, l’historien Vincent Bernard a bien voulu répondre à quelques questions.
L’Affaire Herbefol – Vincent Bernard bonjour et merci de nous consacrer un peu de ton temps pour répondre à quelques questions. Tu es historien et tu viens de publier un ouvrage consacré à la guerre de Sécession, un conflit à propos duquel tu as déjà écrit par le passé (une biographie de Lee, une de Grant et un essai sur la possibilité ou non pour le Sud de remporter la guerre). Peux-tu nous dire comment tu es devenu historien et pourquoi cet intérêt pour la guerre de Sécession ?
Vincent Bernard – Rien de très original. Une passion d’enfance pour l’histoire, et très vite l’histoire militaire, associée à l’adolescence à la pratique assidue du wargame, et approfondie par des études d’histoire à Bordeaux III et un service militaire à l’ancien Service Historique de l’Armée de Terre (aujourd’hui SHD). La guerre de Sécession, spécifiquement, s’est invitée véritablement dans mon imaginaire lorsque pour mes 18 ans ma grand-mère m’a offert l’ouvrage de James McPherson, un classique, dont la lecture a été une sorte de révélation concernant un grand conflit dont j’ignorais presque tout, à l’exception de quelques images simplistes, notamment au travers du Bon la Brute et le Truand, l’un de mes films cultes.
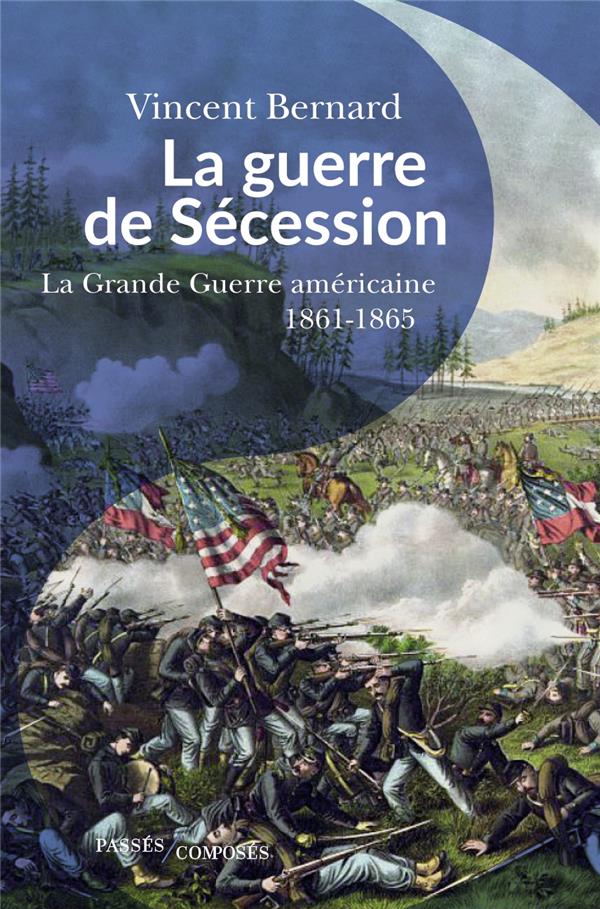 L’Affaire Herbefol – Tu expliques bien qu’au moment où éclate le conflit, Nord et Sud doivent se partager une minuscule armée fédérale, encadrée par une poignée d’officiers qui n’ont pas l’expérience des grandes armées européennes. Les deux camps se retrouvent donc à organiser des armées à partir de presque rien et doivent quasiment tout apprendre. Est-ce que ça te semble une caractéristique récurrente dans les guerres civiles ou est-ce qu’on a là une véritable spécificité de la guerre de Sécession ?
L’Affaire Herbefol – Tu expliques bien qu’au moment où éclate le conflit, Nord et Sud doivent se partager une minuscule armée fédérale, encadrée par une poignée d’officiers qui n’ont pas l’expérience des grandes armées européennes. Les deux camps se retrouvent donc à organiser des armées à partir de presque rien et doivent quasiment tout apprendre. Est-ce que ça te semble une caractéristique récurrente dans les guerres civiles ou est-ce qu’on a là une véritable spécificité de la guerre de Sécession ?
Vincent Bernard – Ce sont les officiers professionnels qui se partagent entre les camps, une grande partie des sudistes (mais pas tous) démissionnant pour rejoindre la confédération ; l’armée régulière en tant qu’institution – environ 16000 hommes – reste fidèle à Washington mais on la maintient telle qu’elle plutôt que de l’utiliser pour l’encadrement des forces de miliciens et de volontaires. On peut évidemment faire l’analogie avec de nombreuses guerres civiles, la révolution russe ou la guerre d’Espagne par exemple, voire la commune de Paris. Mais plutôt qu’une spécificité des guerres civiles ou de la guerre civile, on a plutôt là une spécificité américaine, tout au moins jusqu’à la Seconde guerre mondiale. Que ce soit pour la guerre de 1812, celle de 1846 contre le Mexique, celle de 1898 contre l’Espagne ou lors de l’engagement dans la Première guerre mondiale en 1917, on part d’une armée de terre professionnelle très limitée qui constitue le noyau d’une vaste armée de volontaires.
L’Affaire Herbefol – Le nom anglais est American Civil War (guerre civile américaine) ou Civil War simplement, alors qu’en français et dans d’autres langues européennes, on l’appelle guerre de Sécession. Est-ce que cela peut refléter une différence de perception sur la nature du conflit ?
Vincent Bernard – La guerre a eu bien d’autres noms, celui de Civil War faisant aujourd’hui à peu près consensus outre-atlantique. Mais à l’origine, le Nord parlait plutôt de « war of the rebellion » et le Sud de « war of northern agression » ou de « war of rights », même si nombre de confédérés ont porté fièrement le qualificatif de « rebelles ». Chacun de ces noms porte en lui une connotation particulière. Celui de Civil War est sans doute l’un des plus justes par sa neutralité axiologique mais il implique je pense une idée d’intangibilité et d’indivisibilité des États-Unis, que la guerre remet justement en question et qui n’est vraiment scellée que par la victoire du Nord. On ne s’y dispute pas le pouvoir sur l’ensemble de la nation. Ce qui se joue d’abord c’est l’unité nationale ou la partition et l’indépendance du Sud, tout cela sur fond d’esclavage constituant la principale pomme de discorde entre deux conceptions de la République. L’appellation de « Guerre de Sécession » qui est majoritaire en Europe dès l’origine m’apparaît finalement la plus correcte parce que la plus simplement descriptive de la situation de 1861, mais ce n’est qu’un point de vue.
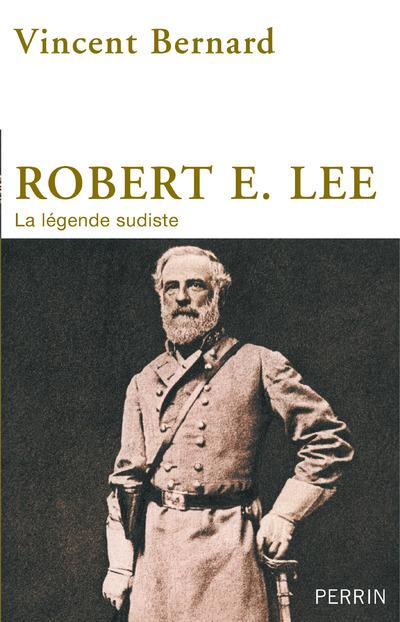 L’Affaire Herbefol – La matière première de l’historien sont les sources (textuelles, archéologiques, etc.) et la guerre de Sécession étant assez récente, on a l’avantage de disposer de très nombreux éléments pour l’étudier (au contraire de certains événements beaucoup plus anciens). Y a-t-il cependant quelque chose qui manque ? Un document ou un élément qui permettrait d’éclairer un point encore sujet à débat ?
L’Affaire Herbefol – La matière première de l’historien sont les sources (textuelles, archéologiques, etc.) et la guerre de Sécession étant assez récente, on a l’avantage de disposer de très nombreux éléments pour l’étudier (au contraire de certains événements beaucoup plus anciens). Y a-t-il cependant quelque chose qui manque ? Un document ou un élément qui permettrait d’éclairer un point encore sujet à débat ?
Vincent Bernard – Les sources sont très nombreuses notamment du fait que le peuple américain est déjà à l’époque – plus au Nord qu’au Sud – particulièrement éduqué. Nombre de simples soldats savent parfaitement lire et écrire, et ne s’en privent pas, y compris de nombreux noirs libres qui se portent volontaires. Il existe aussi des centaines si ce n’est milliers de journaux sur tout le territoire. Ces sources, ainsi que d’innombrables archives publiques ou privées ont aussi la particularité d’être souvent très accessibles, via la numérisation récente et la pléthore d’acteurs (institutions fédérales, d’États, universités, associations mémorielles…) qui y travaillent. Bien sûr, il y a toujours des manques, des lacunes. L’histoire est une matière vivante, toujours en mouvement. Les archives confédérées ont en partie disparu ce qui oblige à des évaluations incertaines concernant les effectifs et la mortalité. Le nombre de morts de la guerre, fixé traditionnellement à 620000 depuis la fin du XIXe siècle fait aujourd’hui l’objet de réévaluations à la hausse grâce au « big data », de même que sont affinées les destructions opérées ainsi que les conséquences économiques et sociales du conflit. L’archéologie contribue d’ailleurs beaucoup à renouveler ou affiner certaines connaissances, sur la vie des esclaves ou certains épisodes militaires. Les mêmes documents peuvent aussi donner lieu à diverses interprétations ou répondre à plusieurs grilles de lecture. Un ouvrage récent a ainsi fait un sort au vieux mythe des « blacks confederates », des noirs censés s’être battus volontairement pour le Sud en montrant notamment que les documents souvent présentés pour accréditer cette idée étaient mal interprétés ou biaisés. Les débats historiographiques abondent donc, même s’ils sont parfois rendus inaudibles par de fortes implications mémorielles et politiques. Le prisme sociologique portant des problématiques contemporaines sensibles comme les questions d’égalité raciale ou de genre a un peu tendance à tout écraser ces dernières années, ouvrant certes des pistes mais au détriment d’autres champs encore largement en friche, à commencer, étonnement, par le champ militaire, loin d’être épuisé, et souvent réduit à quelques images simplistes.
L’Affaire Herbefol – Si le sujet de la guerre de Sécession est traité en français par quelques historiens, dont toi-même et Farid Ameur, on dispose néanmoins d’un corpus considérablement moindre que celui existant en anglais. A part les ouvrages de John Keegan et James M. McPherson, il n’y a pas grand chose de traduit. Est-ce qu’il y en a un ou plusieurs qui te semblent utiles, voire incontournables, sur le sujet et qui mériteraient une traduction, pour celles et ceux qui ne lisent pas l’anglais ? (ou que pourront consulter ceux qui le comprennent)
Vincent Bernard – Stephen Sears, Gordon Rhea, Gary Gallagher… il y en a énormément, dans tous les domaines, selon l’aspect que l’on cherche à approfondir. Par exemple, le récent Armies of deliverance d’Elizabeth Varron, synthèse faible sur le plan militaire mais envisageant le conflit sous l’angle abolitionniste comme une sorte de « croisade » pour libérer le Sud. De mon point de vue McPherson reste encore la grande synthèse en date la plus aboutie car la plus complète et équilibrée, même si un peu vieillissante et exigeante pour un public français sans guère de pré-requis quant à l’histoire américaine. Ce qui manque surtout, c’est un ouvrage concernant la période qui suit la guerre, celle dite de la reconstruction, marquant l’échec de la politique d’émancipation et d’intégration des noirs américains et ouvrant sur un siècle de ségrégation. Le Reconstruction : America’s unfinished revolution d’Eric Foner serait précieux.
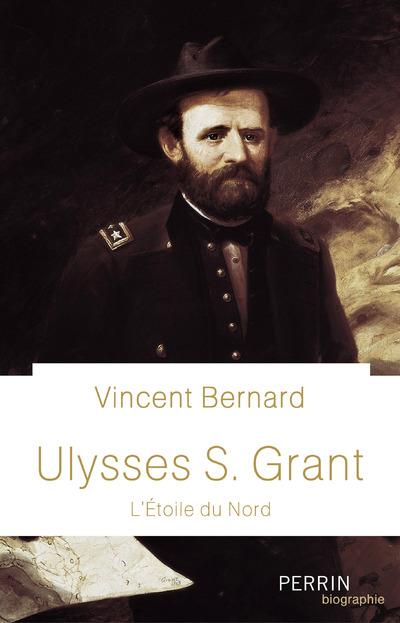 L’Affaire Herbefol – La guerre de Sécession est plus connue du public français par le biais de la fiction que par les cours d’histoire. Tu évoques d’ailleurs l’image déformée que cela produit. Est-ce que malgré tout la fiction peut être un outil utile pour la transmission de l’histoire ? Est-ce que même « Les tuniques bleues » peut permettre d’apprendre quelque chose sans trop le déformer ?
L’Affaire Herbefol – La guerre de Sécession est plus connue du public français par le biais de la fiction que par les cours d’histoire. Tu évoques d’ailleurs l’image déformée que cela produit. Est-ce que malgré tout la fiction peut être un outil utile pour la transmission de l’histoire ? Est-ce que même « Les tuniques bleues » peut permettre d’apprendre quelque chose sans trop le déformer ?
Vincent Bernard – Bien sûr que la fiction est utile même si on ne parle pas là d’apprendre mais plutôt de s’imprégner, en glanant quelques notions et de fixer des images, même simplificatrices ou déformantes. C’est alors le boulot des historiens de remettre les choses en place et en perspective. L’un des grands mérite des Tuniques bleues et d’associer fiction et comédie dans un joyeux bazar chronologique et avec un réalisme au mieux limité (aaah, les charges suicide du 22e de cavalerie…), mais toujours au travers d’événements ou de phénomènes bien réels du conflit, une bataille, les émeutes de la conscription à New York, l’irruption de la photographie, les problèmes de ravitaillement, la fuite des esclaves etc. Résultat grâce à ces albums, beaucoup de gens connaissent au moins l’existence de cette guerre, ses bleus et ses gris, ses grands enjeux, quelques noms célèbres ; c’est de la culture, certes superficielle mais c’est déjà beaucoup.
L’Affaire Herbefol – On fustige parfois les décideurs politiques et militaires de 1914 pour la surprise qu’ont constituée les carnages du début de la première guerre mondiale. En argumentant éventuellement sur le fait que la
première guerre industrielle avait déjà eu lieu sur le continent américain. Y a-t-il vraiment eu à l’époque une cécité du vieux continent sur ce qu’il s’était passé de l’autre côté de l’Atlantique ? Ou l’intervalle d’un demi-siècle entre les deux conflits n’explique-t-il pas à lui seul que la guerre ait pu encore évoluer ?
Vincent Bernard – Il ne faut pas exagérer le parallèle. La guerre de Sécession représente à bien des égards le premier grand conflit industriel moderne mais il correspond à une période de transition, à mi-chemin entre l’ère napoléonienne et les guerres du XXe siècle. L’industrialisation comme les conditions tactiques évoluent encore considérablement entre 1860 et 1914. Ce sont l’amélioration des armes individuelles, la mitrailleuse automatique et l’artillerie à longue portée et à tir rapide de la fin du XIXe siècle qui en quelque sorte achèvent de rendre impuissante une infanterie déjà mise à mal par la multiplication des armes rayées et des fortifications de campagne des années 1850-1870. En 1914, on n’a pris que très partiellement la mesure de cette évolution rapide qui dépasse très largement les conditions d’une guerre de Sécession où il faut rappeler que le soldat meurt encore bien plus des conditions sanitaires que des combats.
L’Affaire Herbefol – La guerre de Sécession étant un événement militaire, elle fait bien évidemment l’objet de nombreux wargames (je pense que c’est l’une des périodes les plus couvertes dans le domaine, après bien sûr la seconde guerre mondiale et peut-être à égalité avec l’époque napoléonienne). Au-delà du plaisir que peut procurer le fait de déplacer des figurines sur un plateau ou des pions sur une carte, est-ce que le wargame peut constituer un outil pratique pour l’historien militaire ?
Vincent Bernard – Bien sûr, outre le plaisir ludique, c’est un outil d’imprégnation et de connaissances, d’abord, de compréhension et d’expérimentation, ensuite. Même si aucun système de jeu ne reflétera jamais vraiment la réalité de l’expérience vécue et des frictions du champ de bataille, des systèmes de simulation bien élaborés et mettant en position de décision à différentes échelles permettent évidemment de mieux apprécier les possibilités réelles d’une bataille ou d’une situation stratégique, souvent bien mieux et plus clairement qu’une simple lecture. J’ai passé des milliers d’heures au dessus d’une table ou devant un écran à examiner des situations, imaginer les possibles, mesurer les limites même si je dois confesser n’être qu’un assez piètre « stratège de salon » ou « général de fauteuil » comme disent les américains. A ce titre, je ne saurai trop conseiller l’ouvrage d’Antoine Bourguilleau, Jouer la guerre, une histoire du wargame qui montre son importance formatrice chez les militaires eux-mêmes.
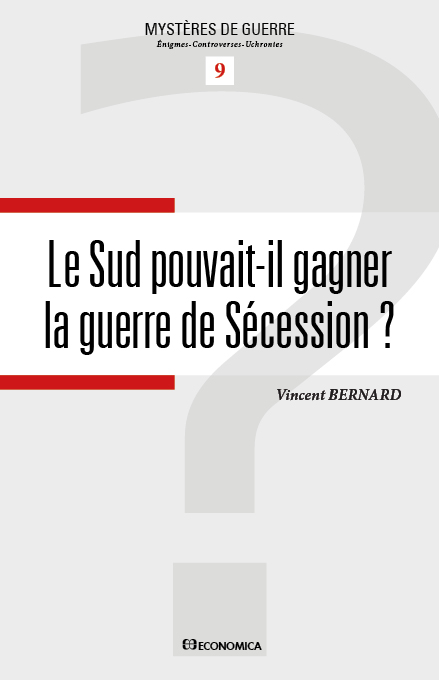 L’Affaire Herbefol – Par sa nature même, le wargame est un objet générateur d’uchronie. Cette forme est beaucoup utilisée par la fiction et là aussi la guerre de Sécession est assez utilisée comme point de divergence (mais essentiellement par des auteurs américains, comme Harry Turtledove). Le principe même de l’uchronie, « que se serait-il passé si… », n’est-il pas une nécessité pour l’étude de l’histoire ?
L’Affaire Herbefol – Par sa nature même, le wargame est un objet générateur d’uchronie. Cette forme est beaucoup utilisée par la fiction et là aussi la guerre de Sécession est assez utilisée comme point de divergence (mais essentiellement par des auteurs américains, comme Harry Turtledove). Le principe même de l’uchronie, « que se serait-il passé si… », n’est-il pas une nécessité pour l’étude de l’histoire ?
Vincent Bernard – Nécessité sans doute pas, dans le sens où l’histoire est ce qu’elle est, et qu’il est toujours délicat de tenter d’en sortir. C’est en revanche passionnant, et les anglo-saxons, tout particulièrement, adorent. C’est un outil intellectuel précieux pour envisager les possibles et aider à se prémunir contre l’écueil des certitudes a posteriori, mieux prendre en compte la contingence des événements. L’une des difficultés de l’historien est de s’immerger dans une période et de tenter faire fi de ce qu’il sait de la suite, de se placer dans l’incertitude du moment, pour comprendre les motivations et les enjeux tels que les voient les contemporains. C’est à ce titre notamment que les journaux rédigés à chaud sont souvent bien plus intéressants et précieux que les mémoires reconstitués à posteriori. La réflexion uchronique est stimulante même s’il faut être infiniment prudent quant à sa pertinence « exploratoire » ; plus on s’éloigne du réel, plus la complexité des interactions et la cascade des conséquences devient impossible à maîtriser et perd en plausibilité.
L’Affaire Herbefol – Lorsque l’on est historien, est-ce que l’on ne risque pas d’avoir un peu trop de livres sur son sujet de prédilection ou au contraire jamais assez ? Et quand on vit en famille, est-ce que cela n’implique pas quelques négociations ?
Vincent Bernard – On en a généralement beaucoup trop pour l’espace dont on dispose et jamais assez pour satisfaire son appétit. J’ai la chance de posséder ma petite « grotte » où peu osent s’aventurer et où je peux stocker sans contradiction familiale. Mais elle aussi est de volume limité. Disons que jusqu’ici, tout va bien. L’apparition des ouvrages numérisés est l’une des réponses possibles, permettant le luxe inouï, avec quelques inconvénients, de transporter des bibliothèques entières dans un disque dur voire une simple clé. Mais peut-on faire de l’histoire sans se vautrer dans le papier jusqu’au cou et le plus souvent aimer ça ? Je suis sans doute déjà trop vieux pour m’en passer.
L’Affaire Herbefol – Merci beaucoup pour cet entretien.